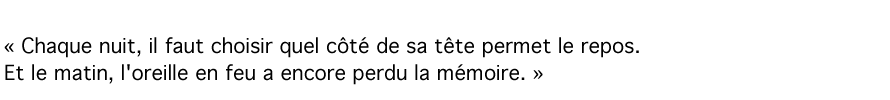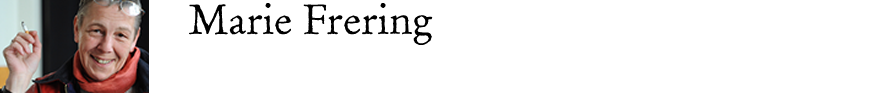Un sombre pré, de lumière envahi
Scène de théâtre équivoque.
Balancés dans un carré de lumière avec sacs et bagages, la porte franchie, nous sommes arrivés.
Le public se presse contre les rambardes, les yeux dévorent, éblouissement dans la nuit.
Jusqu’à être projetés vers les visages et les corps qui nous attendent. La lumière des autres yeux s’éteint, mangée par la découpe des yeux qui s’aimantent. Course nocturne, les regards dans le rétroviseur.
Tbilissi ponctuée comme un chemin de Petit Poucet par des lumignons, têtes rouges de champignons, robe de nylon bordant de sa brillance floue les parasols coca-cola. Des êtres là-dessous, serrés dans la lumière électrique autour des flacons d’ivresse et des paquets de tabac.
Après soixante ans il n’est plus besoin de boire, dit Teklé, nous sommes déjà ivres de temps.
Dans la forêt de Mariamdjaris, on trouve des lanternes japonaises parmi les chênes centenaires. Elles rehaussent le jour de leur fragile pétulance. J’ai appris le français autrefois, dit la vieille femme aux graines de tournesol, mais aujourd’hui je ne me souviens de rien. Ecrire aussi longtemps que cela fait encore mal, avant le souvenir qui adoucit. Rester dans la langueur nostalgique des longues notes tenues du chant des hommes, les corps se rapprochent comme des montagnes qui voudraient s’enlacer. Alors les voix s’enlacent, se répondent dans la résonance de l’écho, la bouche s’approche de l’oreille, s’en éloigne, un bloc de pierre vient de glisser de la pente de la montagne, les titans se sont encore battus comme depuis de longs millénaires ils se battent dans les chants. Le microbus est orange. Notre lanterne japonaise pour arriver dans cette vallée que nous chérissons. La joie me serre le cœur, relayée par la peur dans ces passages où la route est effondrée car l’Aragvi a gonflée ce printemps, creusant de nouvelles berges sous la route.
Quel genre utiliser pour parler de l’Aragvi ? En géorgien, il n’existe que deux genres, l’animé et l’inanimé.
L’un pour les humains, l’autre pour tout le reste du monde.
Cette rivière si calme aujourd’hui même si elle charrie encore dans le brun de ses eaux la terre qu’elle a meurtri, comment lui donner un autre genre qu’animé…
Plus haut dans la vallée de Pshavi, elle est claire, elle mêle le bleu et le vert en un gris d’une douceur infinie. La couleur des yeux de Gotcha le jeune khevisberi. Serviteur des dieux, des titans, il décolle l’abeille qui vient de s’empêtrer dans son miel, ce miel offert aux étrangers sur un plateau de fer blanc, douceur jaune qui s’écoule lentement des rayons partagés en portions à l’aide d’un couteau. Concombres qu’on épluche. Et le miel qui trace de suave présence la fraîcheur. Vaja recopie à pas lents un article de revue. Plus tard, le bras de l’ami appuyé sur son genou, il lit. D’autres lettres que celles de l’alphabet géorgien si rond que l’on ne comprend pas comment les différents r chacun revêtu d’une autre forme de gutturalité puissent y prendre corps. La faux siffle et râpe, l’herbe s’incline et se couche. L’homme se penche, le corps déhanché par l’outil et par la pente de la montagne. Lela monte sur son cheval, elle si petite, se hisse de ses bras forts comme des branches. Elle est belle Lela sur son cheval. Je ne l’ai jamais vue sur son cheval. Mais je vois celle qui invoque Damastoura pour faire cesser la pluie lorsqu’il faudrait aller faucher. Je vois le dieu se penchant vers la petite femme et l’exauçant. Le ciel est si près ici. Et Lela sur son cheval ne claudique plus comme dans cette longue montée où nous sommes allés seuls, elle rapetissant encore dans l’éloignement. Cercles des lieux purs. Où n’a le droit de rentrer que la lumière, la pluie, la neige et le vent, dit Lela. Sur un petit banc, avec un petit instrument, une petite fille chante. Les veines de son cou se tendent, elle pince les cordes de son changouri avec vigueur, c’est de Koppala qu’il s’agit. Le protecteur de sa famille, celui qui avec un long fouet a déséquilibré Avtandil, l’a fait tomber de la falaise qui porte encore son nom, celui qu’on sanctifie de l’épaule droite du bœuf sacrifié, celui à qui on offre le délicieux kada, gâteau divin qu’aucune divine frangipane ne saurait égaler. La voix perce de fierté et le regard nous dépasse. Hamlet, à Chouapro, a perdu sa femme. La jeune Anna a les larmes au bord des yeux et le vin coule dans les verres. De tamada en tamada, les vœux suivent l’Aragvi qui bondit sur les pierres. Dans la montagne fripée de larges rides qui sont comme des vagues immobilisées, la présence de l’homme est marquée par l’écriture d’un champ entouré, d’une culture miniature vue de si loin. Les loups sont proches ici, dans le village voisin ils ont attaqué les ânes. Le fusil est derrière la porte de Jujuna, mais entendent-ils les loups, ces jeunes gars et ces jeunes filles qui regardent la télévision, maintenant que le groupe électrogène et la parabole ont remplacé la veillée nocturne sous les arbres ? Le vieux noyer n’a pas résisté au dernier coup de vent. Il s’est couché de tout son long devant l’étable de Nino. Il est là comme un cadavre derrière nous. Ses branches gardent encore un appel au ciel, le mot géorgien qui désigne la mort signifie « qui a changé de position ». Grand corps effondré, terrassé, un titan encore qui nous parle d’anciennes amours, d’anciens combats, de héros mythologiques. Nous avons perdu la langue, nous œuvrons sans dieux et sans temps. Nous sommes seuls. Oubliés en nous-mêmes. Comme des gorges sans voix, comme des voix sans chants, comme si nous connaissions avant de vivre. Mais qu’est-ce donc que nous avons perdu en Pshavie ? demande Sophie. C’est la bonne question, se poser cette question-là, non pas de ce que nous cherchons mais de ce que nous avons perdu. Les gaillards de Magaroskari, les trois frères, ne savent rien faire d’autre que chanter. Ils chantent sans être là, les deux jeunes frères. L’aîné sait. Les jeunes frères, ils chantent comme si avec impudeur on offrait au monde son ennui. De cet ennui ancestral des montagnes qui ne bougent jamais, de cette eau qui court sans jamais s’arrêter, de cette vie en nous qui s’écoule et qui elle aussi, imprégnant la terre, tracera peut-être une ride sur le front d’une pierre chahutée par la rivière.
Marie Frering, août 2005