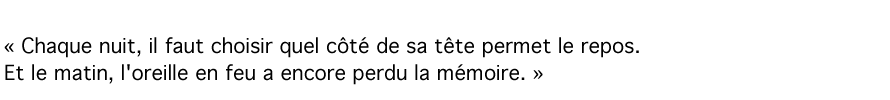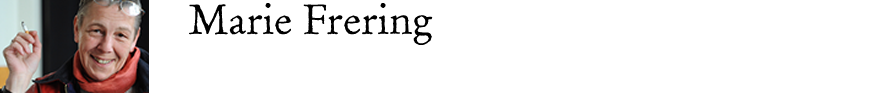Le génie des oiseaux
Relation d’un voyage en Géorgie
Tbilissi
Visages inconnus et souriants, les visages nous emportent à fond de train dans des voitures déglinguées, nos yeux effarés prennent très vite le parti de ne pas regarder à l’avant, nous sautons, volons, slalomons entre les voitures, les nids-de-poule et les brusques manques d’asphalte. Le temps ici, est resté accroché quelque part, enveloppé dans la gangue de la vitesse, ce temps accroché prend l’image d’une ville suspendue au-dessus d’un précipice, un nid d’oiseau aussi solide que fragile, tressé d’herbes robustes, craquements, grincements, fissures. Un faux mouvement, une brusquerie, et elle tombe. Mais le génie des oiseaux colmate, répare, rafistole et l’édifice vibrant tient bon.
Première tablée de femmes, d’autres suivront. Nous sommes à l’intérieur du nid maintenant, nos hôtesses nous nourrissent et nous installent. J’ai bien vu arriver Lali en jupe, la voilà soudain en robe. Les armoires sont pleines, cet appartement serait-il occupé par les filles de Lili lorsque celles-ci sont en amour ? Là-bas chez Lili, les murs fissurés par le tremblement de terre, dans le jardin une ancienne jarre de vin sous un pommier, des confitures de framboises et de raisins offertes dans des coupes ouvragées. Dehors les chiens aboient, des enfants allument un feu au milieu du chemin, la rue est une piste, une ravine certainement lorsqu’il pleut. Dans la pénombre on devine les arbres par le haut, monter par là et il n’y a plus de ville, terre et pierres, prés, vergers sauvages. Ce qui de jour paraît branlant, de nuit se décompose en matériaux accrochés les uns aux autres. La ferraille soutenant le bois, ou bien est-ce l’inverse ? la brique soutenant la ferraille, ou encore le bois soutenant la brique ? Le ressenti de la nuit est plus exact, ça s’accroche et ça se tient ensemble. Prémices aperçus des enlacements des êtres.
Sous-sol d’une galerie marchande, qui n’est plus marchande que par son nom. Derrière une grille cadenassée, un vieil homme a installé sa collection d’animaux empaillés. Les bêtes perdent plumes et poils dans l’humidité de cette caverne, l’homme, lui, a gardé sa verdeur et son humour. Visite d’une Géorgie fantasmagorique, païenne installation de certains dieux de la nature, tigres blancs, ours, vautours, aigles, rapaces et poules d’eau. Mais chacune de ces bêtes immobiles est une personnalité de l’histoire géorgienne. L’homme ne nomme pas le nom des animaux, ou bien comme une information secondaire, il distingue chacun par son nom et prénom. Poètes, philosophes, peintres, musiciens, hommes politiques, jusqu’à Chevardnadze qui a son double empaillé là. Un vieux treillis de camouflage tombe du plafond, l’homme pose derrière son bureau pour une photo souvenir. Les trois petits garçons Besso, Levan et Hirakli ont l’air un peu mal à l’aise dans cet antre figé. Ils se raccrochent à leur mère-louve et choisissent d’aller au zoo.
Boire l’eau des fontaines dans la ville. A petite distance, on regarde l’autre boire, le jet entre ses lèvres ou prendre l’eau au creux de ses mains, boire, se rafraîchir le visage.
La nouvelle Lada a craqué, pas du même craquement que précédemment lorsque Levan n’a pas réussi à éviter un gros trou dans la chaussée. Ce bruit-là fait froncer les sourcils. Impossible de redémarrer. C’est un homme au volant d’une vieille guimbarde qui remorquera deux heures durant la Lada. Tout cela parce que Levan et Lia ont absolument voulu nous emmener sur les hauts de Tbilissi, contempler la ville la nuit. Levan nous l’avouera quelques jours plus tard, il avait bien entendu un bruit suspect du moteur, il espérait que ça tiendrait. Il était hors de question de faire demi-tour alors qu’il nous avait promis cette balade nocturne… Il est temps de commencer à comprendre jusqu’où peut aller l’honneur d’un Géorgien lorsqu’il a des hôtes.
On m’a dit que les paysans géorgiens, avant la collectivisation, au moment où la question était discutée, demandaient : « Dites-nous, je vous prie, comment nous pourrons recevoir nos invités ? ». Le problème est qu’en Géorgie, l’hospitalité a une large part dans le mode de vie concret. C’est un phénomène de la vie quotidienne. Et il est intéressant, que dans les kolkhozes, un fonds spécial a été alloué pour les invités. Note retrouvée dans un des mes carnets, mais je ne sais pas d’où ces phrases sont tirées, juste qu’à cette époque-là je travaillais sur Salomon Mikhoels et le théâtre juif d’Union soviétique. Peut-être des notes de Mikhoels ?
L’architecture de balcons en coursives, sur les maisons et dans les cours intérieures, spécificité de la vie à Tbilissi, j’avais hâte de la voir, j’attendais ces maisons même en sachant que Staline en avait fait démolir beaucoup, trop de contacts entre les gens puisque l’entrée des pièces se fait justement par les coursives. Aujourd’hui on voit encore quelques-uns uns de ces balcons mais sur des maisons qui semblent appartenir à d’inaccessibles, rares et riches nababs. Pourtant dans la vieille ville, passant un porche, des voix d’enfants, des rires, des armoires à côté des portes fermées par un simple rideau, une cour pauvre, des odeurs, un escalier unique qui mène au balcon, dans la cour une entrée de cave, j’entends la voix de Gabin, là-dessous, dans Les Bas-fonds de Gorki filmé par Renoir. Il ne faut pas chercher les vestiges dans la vieille ville, le mode de vie communautaire a persisté là devant nos yeux, tous les jours lorsque nous entrons ou sortons de l’appartement de Lili. Les portes de tous les appartements du palier sont ouvertes, table et chaises sont installées là, des femmes se préparent à peler une grande bassine de toutes petites poires, les enfants sur les genoux, d’autres fois elles sont installées là, oisives, juste à parler. Il suffit de regarder les façades des immeubles, partout, par des poutrelles ferrées dans le béton chaque appartement s’est doté d’une terrasse, d’une vie extérieure. De notre quatorzième étage, on dirait un aménagement de maisons de poupées, une scène de théâtre différente à chaque étage, certains ont fermé ou à demi fermé le quatrième mur par une légère construction de briques.
Une femme à barbe fouille les poubelles sur l’avenue Roustaveli.
Irma, la jolie petite Irma danse, ses petits doigts pointent en haut, en bas à gauche, à droite comme une actrice de kathakali, elle se love autour des vitrines, pivote, les yeux mi-clos, sa voix égrène en chantant VIème, IXème, XIème, XIIIème siècle, diadème de la reine Tamar, icônes de cuivre repoussé, VIème, IXème, XIème, XIIIème siècle… Ses petits doigts pincent et relèvent sa longue jupe pour monter les escaliers. La salle russe est inaccessible par manque de gardiennes. C’est que les gardiennes ont d’autres tâches, celle-là précisément, puisque nous arrivons tout de même à pénétrer dans la salle, frotte le plancher à la paille de fer. Même la jolie Irma s’en fout des peintres russes. Il y a pourtant là une magnifique icône de Roublev… La salle consacrée à Pirosmani se continue par le regard jeté dans la pièce-bureau attenante, encore des peintures de Pirosmani, accrochées de guingois par des ficelles aux conduites de chauffage –comme d’ailleurs toutes les autres toiles du musée.
Sofi a planifié toutes nos activités, la bataille commence pour lui faire admettre la flânerie et l’imprévision. Pas le temps de tous les musées et de toutes les églises, mais Sofi a honte de l’état de son pays, elle veut nous emmener voir les belles choses.
Rinkali, khatchapouri, brochettes, salades, c’est Zaza qui régale aujourd’hui. Il cherche une femme, Sofi a peut-être une cousine à lui présenter. La discussion est sérieuse. Zaza est policier, un atout pour lui, il est payé tous les mois. Il est aujourd’hui le chevalier servant de cinq femmes qui s’entassent dans sa voiture. Première ouverture et avant goût des espaces du Caucase, une petite église perchée au sommet d’une colline, le vent souffle, la vallée s’étend devant nous, les montagnes ourlent d’ampleur le lit des deux fleuves, comment faire entrer cette grandeur dans nos petits appareils photo ?
La tombe du père Gabriel est très courue. Deux jeunes filles, l’air de lycéennes sérieuses et affairées officient sous un parasol à côté de la tombe. Elles sont équipées de tout un attirail pour transvaser l’huile miraculeuse, elles montrent aux pèlerins les photos de l’auréole qui apparaît parfois au-dessus de la tombe. Sofi enlève sa montre et ses bijoux et les pose dans la terre, Lia y met les cartes d’identité de ses deux filles qui vont partir en France, un couple s’agenouille, les officiantes remplissent la petite bouteille de bière d’huile sainte, ils lisent des petits papiers apportés avec eux, se lavent les mains dans la terre de la tombe. Sofi raconte l’histoire du père Gabriel, figure orthodoxe de l’indépendance récente de la Géorgie. Zaza a posé ses lunettes de soleil dans la tombe, Marie-Madeleine s’est mise à l’écart. Montres, bijoux, lunettes de soleil, cartes d’identité bénis sont repris, d’autres endroits miraculeux nous seront encore présentés, jusqu’à une icône photocopiée sur laquelle une tache d’huile est apparue il y a quelques jours.
Assises cette fin de journée, les trois Françaises, à une terrasse proche de la station de métro Grmakhele, près de « chez nous ». De grands bocks de bière, surprenants de légèreté, ils sont en plastique. Un homme ivre veut nous vendre une scie à bois. Je ris. Sur le chemin du retour, je regrette de ne pas lui avoir acheté sa scie.
Khiliani, en Pshavi
Tzutisopeli, mot géorgien signifiant « vie », littéralement « un instant du monde ».
Le lien s’établit entre Tamar, Anano et nous par le déchiffrement, surtout par Jenny, des titres de la gazette géorgienne achetée pour le voyage en microbus jusqu’au village. La beauté des lettres géorgiennes appelle à les écrire, tracer scrupuleusement ces signes, trouver le mouvement pour dessiner chaque lettre. Tamar traduit l’horoscope pour chacune de nous, la timidité est oubliée.
Valéry et Lasha attendaient le microbus pour y récupérer une dizaine de rouleaux de tapisserie enroulés dans du papier journal, liés par des ficelles qui font mal au mains. Un kilomètre de chemin de caillasse, marcher pour arriver quelque part, notion quasi oubliée chez nous, qui sommes au mieux des promeneurs attentifs. Lasha porte une des deux corbeilles de fleurs destinées aux morts du village.
Il y a exactement un an, Maja se noyait dans la rivière. Elle avait quinze ans. Nous rejoignons par un petit sentier la maison des parents, Zaour et Rosa. Ils sont prêts dans la cour. Le petit cortège s’étoffe jusqu’au monticule du cimetière. Zaour porte un grand plat en fer blanc avec de la nourriture, Rosa serre un portrait de sa fille contre elle. Ses autres filles l’entourent. La pierre tombale dressée est gravée de l’image de Maja, jeune fille avec un petit sac à main en bandoulière. La mère étreint la pierre, les filles sont proches d’elle, le père silencieux tourne autour, les enfants se regroupent. La plainte maternelle hurle. Nous sommes saisies, pressées, serrées, les larmes montent, les retenir par pudeur, nous ne connaissons ces gens que depuis une demi-heure, mais à l’intérieur de nous, nous pleurons, pour une fois avec bonheur, nos propres morts.
Le khalardzhveba comptait parmi les plus importantes des cérémonies commémoratives, aussi bien chez les Pshav que les Khevsur. Voici comment se déroulait le rituel : « Ce jour-là, toutes les familles préparaient la vodka et les galettes rituelles, dont une partie était consommée à la maison. On emportait les autres au cimetière, ainsi que de la vodka et du lait bouilli où l’on avait jeté du beurre. Chacun posait la table près de la tombe qu’il honorait, la faisait consacrer par le prêtre de l’Ame, puis tous s’attablaient et consommaient aliments et boissons ». Je cherche aujourd’hui dans ce livre, Le système religieux de la Géorgie païenne, des mots qui me rapprochent de cette émotion qui m’a envahie, de cette cosmogonie ressentie sur ce monticule de cimetière.
Zaour déplie une nappe en plastique, fleurs et carreaux, le pré au-dessus est en pente, il y couche une bouteille de schnaps, un verre de miel, un bocal d’herbes en saumure, pose sur des assiettes des galettes fourrées d’herbes, du pain qu’il tranche. Il remplit les verres de schnaps, quelques gouttes de chaque verre sont versées sur la nourriture, pour l’âme de Maja. D’un geste rond il remplit une assiette de miel qu’il me tend. J’accroche le miel avec le pain, et cette nourriture m’est délicieuse. A côté de moi, les adolescents se serrent, ils arrivent à peine à manger. Mais en mangeant, les sourires reviennent sur les visages, Zaour commence à porter des toasts, à la manière géorgienne, pour les parents, puis les proches, les loins, les morts, les présents, les femmes, les espoirs…
En redescendant, poussant une petite porte de bois, nous allons voir la stèle de Betsina, le père d’Omar, le chaman du village mort en décembre. L’orchidée que nous avons apportée à Omar en hommage à son père fleurit sur le balcon de Schiltigheim. Adossée à un bout de carcasse de camion, la stèle attend de l’argent pour être plantée sur la tombe. Betsina est représenté la hache à la main, la forêt derrière lui.
Chaque prénom que j’écris a pris place en moi, je les nomme autant qu’ils m’ont nommée, chaque prénom est un arbre.
Le soir, grand repas autour de la table en bois à mi-chemin entre la cabane merveilleuse de Deda, la mère et grand-mère, et la maison construite avec l’argent de Sergo, immigré clandestin en Angleterre. C’est à cette maison qu’étaient destinés les rouleaux de papier peint.
Jujuna est une grosse matrone qui ne s’en laisse pas compter. C’est elle qui fait tamada (maître des toasts) ce soir. De sa grosse voix elle remplit les verres et nous buvons. Deda, la petite mère sourit. Je reprends la matrone au mot, dans un harmonieux chahut nous rions, chantons jusqu’à plus soif. Nous avons branché le magnétophone et les polyphonies éclatent dans la nuit.
Manana, une des filles de Rosa vient nous rejoindre. Elle enlace Jenny, ne la lâche plus. Là commence pour Jenny ce qu’elle qualifiera d’expérience pasolinienne, et qui ne cessera de se répéter les jours suivants. Terence Stamp dans Théorème, au premier regard tous tombent amoureux d’elle, petits, grands, hommes, femmes, jeunes, vieux. L’expression de leur amour est absolue et sans contrainte, les gestes sont suaves et tendres, elle est absolument aimée. Il y a une photo magnifique avec Manana et Jenny. Manana regarde l’objectif de tous ses yeux et serre Jenny de tous ses bras.
Cette nuit, dans la chambre de bois de Deda, je rêve que je dors sur la terre.
Le matin nous partons avec Valéry, notre chevalier servant, Lasha –le lumineux-, chasseur-cueilleur, Giorgi, garçon bouvier et Tamar, dans la montagne. Bande d’enfants sauvages, Lasha nous nourrit de mûres et de pommes vertes, Giorgi s’ennuie peut-être à prendre ce chemin, lui qui monte les vaches à l’alpage tous les jours par des tas de raccourcis. Au bout de quelques heures de marche, de sautés de ruisseaux et de glissades boueuses, nous arrivons à notre but, les nuages, la brume qui rend flous nos regards. Lasha attrape des sauterelles, Valéry fume, Giorgi est déjà reparti pour trouver des champignons.
« Si on les questionne à ce sujet, ils répondent que l’instruction a moins de valeur que le bétail. Ils nous l’ont dit souvent : Si tu es instruit, en quoi tu es meilleur ? En couleur, en chair, en vigueur ? »
Je me méfie de mes accents bucoliques et romantiques. Je voudrais parler de Lasha, Valéry, Giorgi, décrire leurs accents sauvages et tendres, dire aussi que ces rencontres de corps, d’yeux et d’âmes m’amènent à plus de sauvagerie et moins de contemplation.
Encore un devoir à accomplir cet après-midi, nous ne sortons pas des deuils, Marie-Madeleine a à charge d’apporter enveloppe et condoléances à une jeune veuve du village voisin. Pièce quasi vide avec la photographie prégnante de Zviad, là sur la commode. Ça en devient presque trop. Pour moi, je m’en sors, mais Jenny est happée, capturée par les bras de la veuve, c’est dans le creux de sa nuque que les larmes coulent, je vois les yeux de Jenny qui semblent dire : encore moi ? Nous revenons sur la route, chiens, cochons, poules, et pierres que je ramasse.
Les amis s’embrassent à l’aube avant de reprendre la course
Ils se font des adieux touchants et des mots précieux déboursent,
De leurs yeux coulent sur des champs des larmes comme d’une source.
Longtemps ils restent cœur à cœur, exténués et sans ressources.
Se griffant les joues, s’arrachant les cheveux comme des surgeons,
L’un en amont, l’autre en aval ils marchent à travers les joncs,
De loin en loin s’interpellant (de douleur les mots nous chargeons).
Le soleil brunit, les voyant renfrognés comme deux donjons.
Oh monde qui nous fais tourner, de quel futur tu vaticines ?
Giorgi a aiguisé la faux ce matin, à côté de lui nous avons cassé des noisettes avec des marteaux. Chacun sait que nous nous séparons bientôt. Nous vivons un petit instant du monde, dont la rivière-salle de bains nous rappelle le bruit.
Difficile retour à la ville. A part que nous étions vingt-deux dans le microbus avec enfants et fougères, je ne me souviens de rien, sans doute vivant encore trop dans cette montagne du Pshavi, encore dans le regret de cette pêche prévue avec Giorgi, nostalgique tout simplement, et tentant dans ces deux heures en microbus de fixer, tenir la mémoire de quelque chose qui m’a totalement dépassée.
Oh monde qui nous fais tourner, de quel futur tu vaticines ?
Ce matin, dans notre chambre à Tbilissi, les trois quarts des coquilles d’escargots ramassées en attendant le microbus se sont réveillées. A six heures du matin, j’entends de drôles de petits bruits, les petits escargots ont envahi notre chambre…
Que peux-t-il se passer après cette visite en Pshavi ?
Pour moi c’est trop et c’est assez. La suite des émotions sera calquée sur ces premières rencontres dans la montagne, déclinaisons qui me rappellent ma vie à Sarajevo, être phagocytée dans et par la pauvreté, aimer, aimer, être aimée, mais renfrognés comme deux donjons.
Il faudrait raconter encore le voyage en Imérétie, Sofi touillant la marmite de la pitance des cochons, Gouram qui ne peut pas s’arrêter de bouger, la baignade dans la rivière, le match de foot entre les deux villages, les trois filles, puis plus loin le village aux loups du cousin de Sofi, le sanctuaire de Kopala, les bouteilles de bière qui témoignent de la vivacité des cultes païens, je me répèterais parce je ne sais pas dire d’où vient et où va cette flèche qui m’a profondément touchée dans le beurre de mon âme.
Probablement a-t-il le désir, probablement a-t-il le besoin de la rosée du lait pour s’humecter la bouche et du beurre pour oindre sa blessure.
Marie Frering, Strasbourg, 1er septembre 2003
Texte publié en deux parties dans La main de singe, nouvelle série, printemps et automne 2004